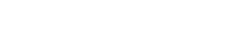Learning 3.0
Nous sommes trois chercheurs en éducation en prise avec trois populations différentes : les enfants, les étudiants et les professionnels. L’IFB, fondé en 1987, est un acteur important de la formation professionnelle en France, spécialisé dans l’acquisition des compétences comportementales en entreprise (soft skills). L’Ifomene, leader en formations à la négociation et à la médiation, a ouvert ses portes en 1998 sur le campus de l’Institut Catholique de Paris. Dans le cadre des universités de Lund et de Malmö (Suède), Alexia conduit un travail de recherche sur l’adéquation des politiques d’éducation à leurs environnements économiques, culturels et sociaux.
Ce qui vient de se passer en France avec les élections législatives éclair nous inspire une réflexion de fond sur une crise du système éducatif en France, qui ne parvient plus à s’acquitter de deux de ses missions fondamentales : intégrer les citoyens à la cité, former les (futurs) travailleurs aux réalités évolutives du travail.
Quelle que soit nos orientations politiques, nous pensons que la situation difficile, dans laquelle se trouve la France au début de l’été 2024, trouve une partie de son explication dans un désarroi collectif, une colère générale, une inadéquation entre les attendus individuels et les possibilités offertes, l’impréparation d’une génération à des réalités d’un nouveau genre.
Si le monde a, dans son ensemble, gagné en prospérité depuis la chute du mur de Berlin en 1989 à la faveur de la mondialisation, il est au moins une catégorie qui a fait exception, celle de la classe moyenne occidentale. Enfant gâté des trente glorieuses, habitué à l’état providence et à la protection sociale, le « petit blanc » européen a vieilli. L’âge moyen, en 2024 est de 42 ans en Europe, contre 39 en Amérique du Nord, 30 en Asie (27 hors Japon et hors Chine), 18 en Afrique. Le déséquilibre croissant entre d’une part sa consommation et la protection sociale dont il bénéficie, et d’autre part son temps de travail réparti tout au long de la vie, l’ont peu à peu rendu moins compétitif que ses homologues.
Au fil des ans, il s’est quelquefois laissé remplacer par :
1. Des travailleurs à faible coût, souvent d’origine étrangère : bâtiment, voirie, transport, livraison, nettoyage, infirmières, sécurité. Ces travailleurs, qui à eux-seuls ont permis au système de tenir à l’époque du Covid (2020-2021), ont révélé l’utilité toute relative des bullshit jobs de la classe moyenne, calfeutrée à l’abri du confinement.
2. Des compétences internationales ou des actifs externalisés à forte valeur ajoutée, comme les centres commerciaux de prestige (Louis Vuitton, L’Oréal)
3. Des automatisations, basées sur la mécanisation, la robotique, des plateformes numériques ou de l’intelligence artificielle.
La middle class française se sent aujourd’hui déclassée. Elle trouve moins facilement sa place dans l’économie. Elle est habituée au confort, à la sécurité, à la consommation de masse, à la liberté de mouvement et d’opinion. Elle veut juste vieillir tranquille ou se réaliser individuellement. La démocratie n’est pour elle qu’un droit inaliénable, qui lui permet de formuler librement son mécontentement ou ses réclamations. Les bulles cognitives, qui l’aspirent à travers les réseaux sociaux, la confortent dans ses certitudes dénonciatrices et revendicatrices. Elle ne pense plus à ce qu’elle peut faire pour son pays, mais uniquement à ce que son pays doit faire pour elle. Elle vote parfois pour des extrêmes, au programme fantaisiste, car il est plus facile de désigner un responsable que de mettre en œuvre des solutions concrètes.
Il nous semble que nous n’en serions pas arrivés là, si le système éducatif en France avait fait correctement son travail et préparé la population à affronter les réalités d’un monde désormais différent. L’avance technologique qu’avait l’Europe à la fin du vingtième siècle vis-à-vis des pays émergents de l’époque a désormais fondu. Il n’y a plus de marché captif ou de ressources naturelles à s’approprier. L’Europe doit désormais partager le gâteau à part égales avec le reste du monde, à fortiori avec l’Asie, plus jeune, plus travailleuse.
Profitons donc de la parenthèse temporelle qui semble s’annoncer après les élections incertaines de juillet 2024, pour mettre les choses à plat. Imaginons qu’il soit pour une fois possible de repenser, sur une page blanche, la totalité du système global de retransmission du savoir (SGTS), un système incluant à la fois l’école, l’enseignement universitaire, la formation professionnelle ou continue, les processus de knowledge management en entreprise, l’ensemble des tutos, des publications et des médias éducatifs. Repensons ce SGTS à partir de zéro, un peu comme le Descartes du Discours de la méthode, envisage, à la sortie de la Renaissance, de reconstruire la Philosophie, en faisant table rase de tous les a priori.
Replaçons-nous aux débuts de la Troisième République, quand Jules Ferry instaure, par la loi du 28 mars 1882, l’instruction primaire gratuite et obligatoire. L’enjeu est d’apporter une réponse aux bouleversements technologiques, économiques et sociaux, qu’induit la première révolution industrielle, quand le sort des Misérables de Victor Hugo, et les flambées de violence révolutionnaire (1830, 1848, 1970) impliquaient une sérieuse révolution des esprits. L’instruction publique s’est employée à développer la transmission de connaissances utiles, et leur conservation dans la mémoire humaine.
Dans la seconde moitié du XXème siècle, s’est développée une économie post-industrielle de « services », qui consistait surtout à manipuler de l’information. L’enseignement scolaire et universitaire, rejoints par les débuts de la formation professionnelle continue, ont alors évolué. Ils ont privilégié les capacités de raisonnement à la mémorisation des connaissances. Il fallait mieux avoir une tête bien faite qu’une tête bien pleine, selon l’expression de Montaigne. Les dissertations écrites, faisant appel à la virtuosité verbale ou la cohérence intellectuelles, devinrent un outil de sélection socio-professionnelle, tandis que le stockage de l’information fut délégué progressivement aux mémoires électroniques. L’usage de la calculatrice fut autorisé en classe, pourvu que l’on sût jongler brillamment avec les constructions abstraites.
Au début du XXIème siècle, le contexte de l’Europe occidentale est encore différent. Depuis son écran connecté, chacun peut accéder directement, librement, gratuitement, à la quasi-totalité de l’information universelle, celle des vivants et celle des morts, tandis que l’intelligence artificielle commence à se propager par tout. Le coût de traitement de l’information abstraite, comme celui de son stockage, tend vers une valeur marginale zéro. Les aptitudes humaines au raisonnement intellectuel sont déclassées ou en passe en de l’être. C’est toute la finalité du SGTS qui est à reconsidérer.
Une bonne nouvelle accompagne toutefois cette mauvaise, car un nouveau besoin fait en même temps son apparition. Si le travail physique des cols bleus des usines et le travail intellectuel des cols blancs des usines administratives, ont perdu de leur valeur ajoutée, de nouvelles missions utiles s’offrent à la middle class européenne. Il s’agit d’un ensemble de services de personne à personne que l’on peut regrouper sous le nom d’Économie Relationnelle. Un nouveau secteur économique est en plein développement, celui du « quaternaire » (services relationnels), en complément ou successeur des secteurs tertiaire (traitement de l’information numérisé), secondaire (activités industrielles robotisées) ou primaire (activités agro-alimentaires mécanisées). Ce secteur quaternaire prolifère partout où une relation de personne à personne est engagée : consultations médicales, suivi hospitalier, assistance ou soins à domicile, conseils personnalisés d’un financiers ou d’un expert, coachings en tous genres, cours particuliers. Il a encore de beaux jours devant lui, car sa scalabilité, c’est-à-dire son automatisation, est par nature, plus limitée. Le secteur quaternaire inaugure une Société de la Singularité, rétive par définition aux traitements de masse, une Gesellschaft plutôt qu’une Gemeinschaft.
Pourquoi alors ne pas imaginer un SGTS de notre temps, qui préparerait aux besoins de demain, plutôt qu’à ceux d’hier ou d’avant-hier ? Plutôt que de demander à des cohortes de 30 élèves, parqués dans une même pièce, d’écouter passivement une information standardisée, de qualité souvent inférieure à celle qu’ils pourraient retrouver en sortant leur smartphone, ne pourrait-on pas leur proposer plutôt d’expérimenter les postures et les comportements qui leurs garantiraient une place dans un tissu économique moins standardisé, moins centralisé, plus autonome, plus évolutif ? Plutôt que d’entraîner des générations d’élèves à disserter sur des textes classiques, que plus personne ne lit, pourquoi ne pas leur proposer des expériences théâtrales, sociales ou entrepreneuriales, en partenariat avec les entreprises ou la société civiles ? Pourquoi ne pas entraîner les ex-élèves de l’ex-école à s’entraîner aux compétences comportementales, dont ils auront effectivement besoin pour se trouver une place dans l’étoffe de l’Économie Relationnelle : écouter attentivement, valoriser ou motiver son interlocuteur, s’exprimer de manière intelligible et convaincante, affirmer calmement son point de vue ? Le SGTS pourrait faire converger dans la même direction l’école, l’université, la formation continueet les processus de knowledge management en entreprise. Au stockage des connaissance ou au traitement de l’information écrite, pourraient se substituer des ateliers d’interaction avec de vraies personnes ou de gestion de projets interdisciplinaires, comme la réalisation d’un documentaire, l’organisation d’un événement, la fédération d’une communauté, le lancement et la promotion d’une plateforme en ligne.
Le lieu dédié pourrait être partout, dans la vraie vie, en tous cas hors de la salle de classe de Jules Ferry. Le temps dédié pourrait être n’importe quand, dans la vraie vie, en tous cas hors des horaires prédéfinis et standardisés. L’accompagnant dédié pourrait être un acteur économique ou social de la vraie vie, en tous cas pas forcément un diplômé du CAPES ou de l’agrégation. Le budget de ce SGTS, construit et réconcilié avec le monde réel, serait donc bien inférieur aux charges actuelles. On pourrait même imaginer un système de troc ou de monnaie alternative, comme le Saber, utilisé par les étudiants du Brésil, en manque de professeurs. Les locaux pourraient être partiellement remplacés par des espaces de coworking ou de co-learning. Les services administratifs du ministère et les personnels non-enseignants, qui représentent en 2022-2023, environ 300.000 agents sur 1,2 million, soit 25% des effectifs de l’Éducation Nationale, pourraient être partiellement réimpliqués au front office, en relation avec les apprenants. L’investissement administratif des organismes de formation dans le renouvellement formel de leurs dossiers d’homologations pourrait être réaffecté à la recherche pédagogique opérationnelle.
Alors l’école se remettrait au service de la Nation, et non l’inverse. La formation professionnelle pourrait faire à nouveau son travail de développement des compétences au lieu de monter des dossiers de conformité. Les citoyens déboussolés pourraient retrouver leur place dans la réalité économique et sociale, en même temps que du sens à leur vie. Les générations à venir pourraient à nouveau s’investir dans une action collectivement utile, plutôt que dans une colère aveugle, issue d’un désarroi qui ne l’est pas moins.
Alexia Bocquet, chercheuse en éducation, diplômée de l’Université d’Amsterdam et de Malmö,
Chimène Bocquet, directrice de l’Ifomene (ICP, Paris),
François Bocquet, directeur de l’institut IFB (Paris).